A l’occasion de la réédition aux Editions Gope de Malaisie, un certain regard de Sylvie Gradeler et Serge Jardin, nous vous invitons à découvrir au cours des trois prochaines semaines trois extraits d’articles en lien avec la littérature et tirés de ce livre foisonnant. Premier de la série : une présentation de romans d’espionnage des années 1960 ayant pris pour cadre la Malaisie, alors vue comme une terre d’exotisme kitsch et un paradis d’agents secrets de tout poil… Pour en savoir plus sur Malaisie, un certain regard, notre entretien avec les auteurs est toujours disponible ici.
Malaisie, nid d’espions
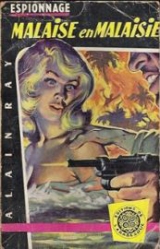 James Bond n’y est peut-être pas venu, mais cela n’empêche pas la Malaisie d’attirer les espions comme le miel les mouches. Le commandant René des Services anglais y arrive le premier pour démasquer des agents chinois qui ont fait sauter la voie ferrée qui amène l’étain vers le port de Singapour. Il est suivi de près par Nicolas Calone des Services français, à la recherche d’un collègue, qui est aussi le directeur d’une mine extrayant du cobalt dont les Russes ont besoin pour leurs fusées.
James Bond n’y est peut-être pas venu, mais cela n’empêche pas la Malaisie d’attirer les espions comme le miel les mouches. Le commandant René des Services anglais y arrive le premier pour démasquer des agents chinois qui ont fait sauter la voie ferrée qui amène l’étain vers le port de Singapour. Il est suivi de près par Nicolas Calone des Services français, à la recherche d’un collègue, qui est aussi le directeur d’une mine extrayant du cobalt dont les Russes ont besoin pour leurs fusées.
Les espions y grouillent pendant les années 60. Ils boivent du White Horse et fument des Camel. Les montres sont des Lip, et un Convair quadriréacteurs assure la liaison entre Paris et Singapour en 20 heures dont 4 escales d’une heure (Rome, Suez, Karachi et Calcutta). Armand Lelong dit Le Magicien, du SDECE, lutte contre les services Chinois qui ont établi une base secrète sur une plantation d’hévéas française dans le Pahang, pour fomenter une insurrection armée. André Montiac, de la même agence, doit détruire une organisation chinoise dans le Johor, qui s’intéresse de trop près à un projet de satellite anglo-français. Frédéric Baron dit L’Artiste, des mêmes services, se rend au Sarawak, où Pékin a installé une base secrète pour aider le parti communiste indonésien à s’emparer du pouvoir à Djakarta (…)
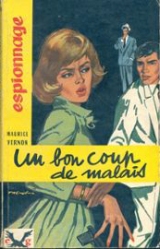 Dans les années 70, si Francis Coplan (nom de code FX 18) défend toujours les intérêts français dans la région, on note la présence d’un indépendant : Bébé Guernica dit Le Condor, venu enquêter sur un réseau de drogue que des touristes acheminent au Royaume-Uni. Le célèbre commissaire San-Antonio fait un bref passage à Kuala Lumpur dans Poison d’avril (Fleuve Noir, 1985) en route pour Singapour où on doit assassiner le président des Etats-Unis. Mais c’est surtout la CIA qui va s’imposer avec Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117 et SAS, Son Altesse Sérénissime, le prince autrichien Malko Linge à la veille de l‘an 2000. Les Boeing 777 se posent maintenant à Kuala Lumpur, les montres sont des Breitling, on boit du Defender et on ne fume plus.
Dans les années 70, si Francis Coplan (nom de code FX 18) défend toujours les intérêts français dans la région, on note la présence d’un indépendant : Bébé Guernica dit Le Condor, venu enquêter sur un réseau de drogue que des touristes acheminent au Royaume-Uni. Le célèbre commissaire San-Antonio fait un bref passage à Kuala Lumpur dans Poison d’avril (Fleuve Noir, 1985) en route pour Singapour où on doit assassiner le président des Etats-Unis. Mais c’est surtout la CIA qui va s’imposer avec Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117 et SAS, Son Altesse Sérénissime, le prince autrichien Malko Linge à la veille de l‘an 2000. Les Boeing 777 se posent maintenant à Kuala Lumpur, les montres sont des Breitling, on boit du Defender et on ne fume plus.
Loin des grands auteurs, nous sommes là, dans la paralittérature, la littérature de gare, comme on l’appelle aussi, car vendue plus souvent dans des kiosques à journaux que dans de vénérables librairies. Si faire œuvre littéraire n’est pas le but principal chez ces forçats de l’écriture, par contre celui qui s’intéresse aux représentations de la Malaisie, ne peut négliger ce puits à images. Quelle Malaisie ces espions ont-ils vue, quel pays nous racontent-ils ?
Nous ne prétendons pas avoir lu tous les ouvrages du genre. Nous avons retenu treize romans d’espionnage, ceux que nous avons trouvés, écrits en français, dont l’action se situe tout ou en partie en Malaisie. Dix romans ont été écrits entre 1958 et 1973, les années 60 sont l’apogée du genre. Nous n’en avons trouvé qu’un au milieu des années 80, et un autre au tournant du siècle.
Du rideau au voile
 Il importe d’abord de préciser l’aire géopolitique et le contexte historique dans lesquels nos espions opèrent. La Malaisie, c’est dans la plupart de ces romans, la Péninsule malaise ou Malaisie occidentale, associée ou non à Singapour. Trois de ces romans : Singapour appelle Coplan (Fleuve Noir, 1973), Mission à Singapour (Presses Noires, 1965) et Le pékin de Singapour (André Martel, 1966) ont Singapour dans leur titre : le nom est sans doute plus évocateur dans les années 60 et 70. Trois romans se déroulent tout ou en partie au Sarawak, au nord de l’île de Bornéo ou Malaisie orientale. C’est un nom encore aujourd’hui bien mystérieux pour beaucoup. Aussi préfère-t-on Bornéo, Malaisie et Singapour dans les titres, comme dans Objectif Bornéo (Albin Michel, 1967), Malaise en Malaisie (L’Arabesque, 1958) ou bien encore Le pékin de Singapour.
Il importe d’abord de préciser l’aire géopolitique et le contexte historique dans lesquels nos espions opèrent. La Malaisie, c’est dans la plupart de ces romans, la Péninsule malaise ou Malaisie occidentale, associée ou non à Singapour. Trois de ces romans : Singapour appelle Coplan (Fleuve Noir, 1973), Mission à Singapour (Presses Noires, 1965) et Le pékin de Singapour (André Martel, 1966) ont Singapour dans leur titre : le nom est sans doute plus évocateur dans les années 60 et 70. Trois romans se déroulent tout ou en partie au Sarawak, au nord de l’île de Bornéo ou Malaisie orientale. C’est un nom encore aujourd’hui bien mystérieux pour beaucoup. Aussi préfère-t-on Bornéo, Malaisie et Singapour dans les titres, comme dans Objectif Bornéo (Albin Michel, 1967), Malaise en Malaisie (L’Arabesque, 1958) ou bien encore Le pékin de Singapour.
Le cadre géopolitique n’est pas toujours bien défini. Ainsi Mission secrète en Malaisie (Valmont, 1959) se passe à la veille de l’indépendance, en 1957. Curieusement l’auteur nous présente le cadre administratif colonial de la Malaisie anglaise avant l’invasion japonaise en 1941. En effet, son héros ne peut s’envoler d’Orly pour Saigon à bord d’un avion Air France qu’à partir de 1952. Ou bien encore, la situation de Singapour évolue sans doute trop rapidement pour nos auteurs dans les années 60 : colonie anglaise jusqu’en 1963, membre de la Fédération de Malaisie jusqu’en 1965, et république indépendante depuis. Il faut attendre les romans des années 70 pour que les doutes sur le statut de Singapour disparaissent.
 Le terme qui prête le plus à confusion, est celui de Malais. La Malaisie d’hier ou Archipel malais a donné naissance, avec la décolonisation, à de nouvelles entités politiques : Brunei, Indonésie, Malaisie, et Singapour. Nous avons écarté les titres qui l’utilisent, comme Les sortilèges malais ou Traquenard malais mais dont l’action se situe en Indonésie. Dans tous ces romans, le terme de Malais est indifféremment utilisé pour désigner une ethnie et l’habitant de la Malaisie. Alors que depuis 1957, le terme de Malais est utilisé en Malaisie, pour définir une ethnie, qui pratique l’Islam, la langue et les coutumes malaises. L’habitant du pays, lui, s’appelle un Malaisien, qui peut être indifféremment d’origine chinoise, indienne, malaise ou autre. Aucun roman ne mentionne cette distinction, pourtant un trait original et, capital, à la compréhension de ce pays aujourd’hui.
Le terme qui prête le plus à confusion, est celui de Malais. La Malaisie d’hier ou Archipel malais a donné naissance, avec la décolonisation, à de nouvelles entités politiques : Brunei, Indonésie, Malaisie, et Singapour. Nous avons écarté les titres qui l’utilisent, comme Les sortilèges malais ou Traquenard malais mais dont l’action se situe en Indonésie. Dans tous ces romans, le terme de Malais est indifféremment utilisé pour désigner une ethnie et l’habitant de la Malaisie. Alors que depuis 1957, le terme de Malais est utilisé en Malaisie, pour définir une ethnie, qui pratique l’Islam, la langue et les coutumes malaises. L’habitant du pays, lui, s’appelle un Malaisien, qui peut être indifféremment d’origine chinoise, indienne, malaise ou autre. Aucun roman ne mentionne cette distinction, pourtant un trait original et, capital, à la compréhension de ce pays aujourd’hui.
En ce qui concerne le contexte historique, un seul de ces romans se passe avant l’indépendance, quand trois dollars de Malaisie (le ringgit ne s’imposera qu’en 1967) valait un dollar américain, comme aujourd’hui. Malaise en Malaisie se déroule dans les mois qui suivent la naissance du nouvel état. Le nom des rues est encore en anglais. Cette période est aussi le temps de l’insurrection communiste (1948-1960) (…)
 Après l’indépendance, l’étape suivante, en 1963, cruciale pour le nouveau pays, est son élargissement à Singapour et aux deux états situés au nord de l’île de Bornéo : le Sabah et le Sarawak. Cela provoque une période de confrontation, de guerre larvée, avec l’Indonésie qui revendique toute l’île de Bornéo. La « konfrontasi » prend fin peu après le coup d’état, qui en 1965, renverse Sukarno, le président indonésien. Quatre romans ont pour cadre cette période : si deux d’entre eux : Un bon coup de malais (Le Gerfaut, 1964) et Mission à Singapour l’évoquent à peine, par contre, c’est le thème central des deux autres : A malais, malais et demi (Promodifa, 1977) et Le pékin de Singapour.
Après l’indépendance, l’étape suivante, en 1963, cruciale pour le nouveau pays, est son élargissement à Singapour et aux deux états situés au nord de l’île de Bornéo : le Sabah et le Sarawak. Cela provoque une période de confrontation, de guerre larvée, avec l’Indonésie qui revendique toute l’île de Bornéo. La « konfrontasi » prend fin peu après le coup d’état, qui en 1965, renverse Sukarno, le président indonésien. Quatre romans ont pour cadre cette période : si deux d’entre eux : Un bon coup de malais (Le Gerfaut, 1964) et Mission à Singapour l’évoquent à peine, par contre, c’est le thème central des deux autres : A malais, malais et demi (Promodifa, 1977) et Le pékin de Singapour.
Avec Malaise en Malaysia (Presses de la Cité, 1971), la Malaisie a déjà traversé la période la plus douloureuse de sa courte histoire : les émeutes raciales de 1969. L’insurrection communiste, ou l’Etat d’Urgence, comme l’appelèrent les Anglais, et non guerre, pour éviter que les primes d’assurance des planteurs n’augmentent, ne représente plus un véritable danger militaire ou politique, même si les derniers communistes réfugiés au sud de la Thaïlande ne déposeront les armes qu’en 1989. En 1971, le nom des rues est toujours en anglais et le ringgit vaut deux francs français. Saloma, la prima donna malaise est au sommet de sa carrière. La compagnie aérienne est encore la Malaysia-Singapore Airlines, elle ne deviendra la Malaysian Airline System qu’en 1972 (…)
 A malais, malais et demi échappe à toute référence à l’actualité, c’est un fait de société qui en est le prétexte: le trafic de la drogue. Ce sujet resurgit dans L’amour fou du colonel Chang (Malko Productions, 2000), où l’on apprend qu’une douzaine de trafiquants sont pendus chaque année, même des étrangers ! La condamnation à mort de Béatrice Saubin en 1982 par le tribunal de Penang y est sans doute pour quelque chose. Mais avec ce livre, on retrouve aussi un contexte historique : la crise financière de 1997, et ses conséquences politiques. Al Gore, invité en Malaisie, froisse le Premier Ministre, le Dr Mahathir en évoquant l’état des Droits de l’Homme en Malaisie (…)
A malais, malais et demi échappe à toute référence à l’actualité, c’est un fait de société qui en est le prétexte: le trafic de la drogue. Ce sujet resurgit dans L’amour fou du colonel Chang (Malko Productions, 2000), où l’on apprend qu’une douzaine de trafiquants sont pendus chaque année, même des étrangers ! La condamnation à mort de Béatrice Saubin en 1982 par le tribunal de Penang y est sans doute pour quelque chose. Mais avec ce livre, on retrouve aussi un contexte historique : la crise financière de 1997, et ses conséquences politiques. Al Gore, invité en Malaisie, froisse le Premier Ministre, le Dr Mahathir en évoquant l’état des Droits de l’Homme en Malaisie (…)
Si le cadre historico-politique de la Malaisie est, à quelques exceptions près, peu ou mal défini, l’action de ces romans s’inscrit dans un cadre plus général, mondial. C’est pour l’essentiel, sauf le dernier écrit en 2000, le contexte de la guerre froide. Ce n’est peut-être pas un hasard, si l’apogée du genre culmine dans les années 60, c’est aussi le temps fort de la guerre froide, avec la crise des missiles cubains en 1962.
La mise en scène de ces romans est particulièrement simple. D’un côté, les bons, les agents secrets, qui sans exception appartiennent à l’Occident (CIA, MI6 et SDECE) et de l’autre les mauvais. Du côté des méchants, ce sont les Chinois qui arrivent en tête, dans 7 romans (…). Les Indonésiens sont à égalité avec les Russes : 2 romans chacun. Ils sont tantôt Chinois, Indonésiens ou Russes, les communistes sont bien sûr les ennemis tout désignés en cette période de guerre froide. Les deux dangers qui menacent l’Occident se rencontrent et se renforcent mutuellement ici : le péril communiste et le péril jaune !
La présence modeste des Russes (…) s’explique par la situation géographique : la plus grande proximité du rideau de bambou que celle du rideau de fer. La Chine est la puissance qu’il faut contenir. La composition ethnique de la population, où les Chinois sont une minorité très importante, vient renforcer ce risque. Ces romans illustrent aussi une réalité historique : la Malaisie est une ancienne colonie britannique. Les services français y interviennent souvent en association avec les services de Sa Gracieuse Majesté. En 1973, l’Europe fait son apparition, avec une collaboration des services secrets anglo-franco-germaniques dans Singapour appelle Coplan. Mais la chronologie traduit le recul inéluctable de l’influence française dans le monde, et la CIA finit par remplacer le SDECE.
Un parangon d’exotisme
 La description du cadre naturel suffit à montrer que la plupart de nos auteurs n’ont jamais quitté leur salon parisien. Dans Le pékin de Singapour, une approche en avion permet de découvrir la végétation luxuriante de la jungle, mêlée aux damiers brillants des cultures en terrasses, qui rappelle davantage Bali que Singapour. Tandis que dans Objectif Bornéo, la savane remplace la forêt pluviale de Bornéo. Dans le même roman, la baie de Kuching au bord de la Mer de Chine, est une splendeur, et la ville est traversée par une coulée de boue qui emporte tout sur son passage, négligeant que Kuching est située dans une plaine alluviale à… 25 km de la mer (…)
La description du cadre naturel suffit à montrer que la plupart de nos auteurs n’ont jamais quitté leur salon parisien. Dans Le pékin de Singapour, une approche en avion permet de découvrir la végétation luxuriante de la jungle, mêlée aux damiers brillants des cultures en terrasses, qui rappelle davantage Bali que Singapour. Tandis que dans Objectif Bornéo, la savane remplace la forêt pluviale de Bornéo. Dans le même roman, la baie de Kuching au bord de la Mer de Chine, est une splendeur, et la ville est traversée par une coulée de boue qui emporte tout sur son passage, négligeant que Kuching est située dans une plaine alluviale à… 25 km de la mer (…)
Comme dans Malaise en Malaisie, la forêt est souvent marécageuse, c’est toujours un enchevêtrement de lianes et de racines. L’atmosphère y est lourde, saturée d’odeurs fétides et écœurantes. Pour qui n’a pas connu les orages de la jungle malaise, rien ne peut lui en donner une idée. Ce n’est plus à l’échelle humaine. Les hommes contiennent à grand peine la végétation luxuriante, quarante huit heures suffisent parfois pour noyer l’œuvre humaine. Les marais sont profonds et la vase puante. Les serpents vivent dans l’air comme dans l’eau, les sangsues sont voraces, et dans Le pékin de Singapour le cynocéphale africain fait son apparition, détrônant le nasique et l’orang-outang (…)
On atteint les sommets dans Mission secrète en Malaisie, avec le caquetage incessant des oiseaux, les cris assourdissants des singes et la chaleur moite. Cet enfer vert, où les lianes enchevêtrées forment un magma, où l’air est épais et asphyxiant, à cause de l’émanation des sucs en décomposition. On entend le cri de l’ara (on aurait préféré celui du calao). Les animaux grouillent sous l’humus, les scorpions s’enfuient sous les pieds. Dans la demi-obscurité verdâtre volent des aigles nains. Les fourmis malaises ne piquent pas, mais brûlent la peau. Ici pullulent les crotales, les najas, et les vipères, mais attention au chicharramachacuy (un insecte volant avec un dard venimeux) et à la shamaman (un oiseau gigantesque) ou bien encore à l’arbre de catawa dont les racines donnent les pires maladies tropicales !
 Les hommes n’ont guère à envier au traitement subi par la nature. Malaise en Malaysia nous met tout de suite en garde : avec les Jaunes, aussi bien Malais que Chinois, on ne peut jamais savoir. Dans Mission secrète en Malaisie, les Chinois sont des Tchink rapaces, l’Indien mâche du bétel, et le Malais a les cheveux crépus. Curieusement les Tamouls travaillent dans les mines d’étain, et non dans les plantations (…) Dans A malais, malais et demi, les Dayaks ne sont pas mieux traités : ils ont le visage teint de vermillon, le corps tatoué de serpents blancs et bleus. Ils portent une corde qui leur sert de cache-sexe et leur ceint la taille. Ils portent des crânes à la ceinture maintenus par les narines. Ils n’ont pas un vocabulaire très étendu (…)
Les hommes n’ont guère à envier au traitement subi par la nature. Malaise en Malaysia nous met tout de suite en garde : avec les Jaunes, aussi bien Malais que Chinois, on ne peut jamais savoir. Dans Mission secrète en Malaisie, les Chinois sont des Tchink rapaces, l’Indien mâche du bétel, et le Malais a les cheveux crépus. Curieusement les Tamouls travaillent dans les mines d’étain, et non dans les plantations (…) Dans A malais, malais et demi, les Dayaks ne sont pas mieux traités : ils ont le visage teint de vermillon, le corps tatoué de serpents blancs et bleus. Ils portent une corde qui leur sert de cache-sexe et leur ceint la taille. Ils portent des crânes à la ceinture maintenus par les narines. Ils n’ont pas un vocabulaire très étendu (…)
Si l’on en croit Mission à Singapour, les femmes ne peuvent que faire rêver l’homme occidental: elles sont douces, aimables, expertes aux jeux de l’amour et entièrement dévouées à celui qu’elles aiment. Leurs yeux en amande font leurs sourires plus caressants encore. Malgré toute la science érotique dont elles sont capables, Malaise en Malaysia se désole de l’impassibilité des Asiatiques pendant l’amour. Mais OSS 117 fait une rencontre heureuse: des Indiennes, elle a la finesse de traits et d’attaches. Son sang chinois lui confère un visage énigmatique et de grands yeux en amandes finement bridés. L’opulence des Malaises transparait dans la plénitude de son corps ferme et harmonieusement galbé.
 Outre les caractéristiques humaines décrites ci-dessus, le cadre culturel est largement défini par le recours à des mots malais intraduisibles ou volontairement non traduits. Nos auteurs ont ici largement puisé aux sources de leur dictionnaire, plus qu’à une connaissance du terrain. Le record de citation revient au kriss. Il figure dans dix romans sur douze (…) Vient ensuite le kampung, qui est tout simplement le village malais. Puis ils sont cités à plusieurs reprises : le durian, le parang et le sarong (…) Si l’on n’est guère surpris de trouver au fil des pages : amok, batik, kriss, prao, rickshaw, ou sarong, par contre, Sabotages en Malaisie (L’Arabesque, 1968) nous offre un véritable florilège, où il est question d’amah (servante), de mata-mata (détective), de merdeka (indépendance), de songkok (toque noire en velours), de satay (brochette de viande servie avec une sauce à la cacahouète), de gula Malacca (sucre de palme), d’atap (toiture de palme), de kerbau (buffle) (…)
Outre les caractéristiques humaines décrites ci-dessus, le cadre culturel est largement défini par le recours à des mots malais intraduisibles ou volontairement non traduits. Nos auteurs ont ici largement puisé aux sources de leur dictionnaire, plus qu’à une connaissance du terrain. Le record de citation revient au kriss. Il figure dans dix romans sur douze (…) Vient ensuite le kampung, qui est tout simplement le village malais. Puis ils sont cités à plusieurs reprises : le durian, le parang et le sarong (…) Si l’on n’est guère surpris de trouver au fil des pages : amok, batik, kriss, prao, rickshaw, ou sarong, par contre, Sabotages en Malaisie (L’Arabesque, 1968) nous offre un véritable florilège, où il est question d’amah (servante), de mata-mata (détective), de merdeka (indépendance), de songkok (toque noire en velours), de satay (brochette de viande servie avec une sauce à la cacahouète), de gula Malacca (sucre de palme), d’atap (toiture de palme), de kerbau (buffle) (…)
Suivez le guide !
Avec le réchauffement de la guerre froide, le roman d’espionnage va connaître son déclin. Les titres se raréfient, seules les valeurs sûres perdurent (OSS 117 créé en 1949 a disparu en 1992, FX 18 a vécu de 1953 à 1999, et SAS né en 1965 voit sa carrière s’interrompre avec le décès de son auteur en 2013). Le genre évolue avec son temps : le sexe y occupe de plus en plus de place. Le roman d’espionnage a pris son envol avec l’apparition de l’aviation commerciale. Le commissaire de police du polar n’a guère vocation a quitté l’hexagone, tandis que l’agent secret se fait commis voyageur. Nous noterons une exception toutefois : le commissaire San-Antonio. Profitant de l’explosion des transports aériens, le roman d’espionnage va se déplacer du kiosque de la gare vers celui de l’aérogare. Il va surfer sur la vague du tourisme international.
 Jusqu’à la fin des années 60, les villes traversées ne sont jamais visitées. Les lieux cités sont simplement extraits d’atlas géographiques. Avec les années 70, les péripéties de l’aventure vont permettre une véritable découverte touristique du pays. Singapour a une longueur d’avance : OSS 117 la visite en 1969 (Cinq gars pour Singapour), FX 13 en 1973 (Singapour appelle Coplan) et SAS en 1976 (Le disparu de Singapour). SAS a commencé ses aventures en Asie du Sud-Est par Bangkok en 1968, il visitera les neuf autres pays de l’ASEAN avant de finalement débarquer à Kuala Lumpur en l’an 2000. Ce n’est sans doute pas un hasard, à la différence des neuf autres romans, ni le nom du pays ou de la capitale ne figure dans le titre de ce dernier. Rien d’étonnant, la Malaisie entre plus tardivement dans les brochures touristiques. Le ministère du commerce et de l’industrie ne crée un département touristique (Tourist Development Corporation) qu’en 1972.
Jusqu’à la fin des années 60, les villes traversées ne sont jamais visitées. Les lieux cités sont simplement extraits d’atlas géographiques. Avec les années 70, les péripéties de l’aventure vont permettre une véritable découverte touristique du pays. Singapour a une longueur d’avance : OSS 117 la visite en 1969 (Cinq gars pour Singapour), FX 13 en 1973 (Singapour appelle Coplan) et SAS en 1976 (Le disparu de Singapour). SAS a commencé ses aventures en Asie du Sud-Est par Bangkok en 1968, il visitera les neuf autres pays de l’ASEAN avant de finalement débarquer à Kuala Lumpur en l’an 2000. Ce n’est sans doute pas un hasard, à la différence des neuf autres romans, ni le nom du pays ou de la capitale ne figure dans le titre de ce dernier. Rien d’étonnant, la Malaisie entre plus tardivement dans les brochures touristiques. Le ministère du commerce et de l’industrie ne crée un département touristique (Tourist Development Corporation) qu’en 1972.
Malaise en Malaysia peut se lire comme une invitation à visiter la Malaisie. A Kuala Lumpur, on descend à l’hôtel Fédéral, le premier grand hôtel construit pour accueillir les dignitaires venus assister aux cérémonies de l’Indépendance en 1957. On se rend d’abord sur la Place de l’Indépendance, entourée de ses bâtiments coloniaux, puis à la Mosquée Nationale, et dans les Jardins du Lac dominés par le Monument National. Dans la banlieue nord, il faut visiter les Grottes de Batu, de préférence pendant le festival de Thaipusam, et gravir son célèbre escalier. Une première excursion hors de la ville vous entraîne vers la station d’altitude la plus proche : Fraser’s Hill, créée par les Anglais à la recherche de fraîcheur. Ensuite la deuxième étape importante est consacrée à la Perle de l’Orient, qui a déjà perdue son statut de port franc, mais où la mer est encore bleue. A Penang, on visite le Temple des Serpents, et on descend à l’E&O, qui vient récemment de retrouver son lustre d’antan, ainé vénérable du célèbre Raffles de Singapour.
 Enfin la troisième étape nous emmène de l’autre côté de la Mer de Chine, en Malaisie orientale, au Sarawak, dans la capitale des Rajahs Blancs : Kuching. Le premier hôtel de la ville à offrir des baignoires avec l’eau chaude, et l’air conditionné est l’Aurora (on a construit depuis l’hôtel Merdeka à la place). On se promène au long de la rivière (Main Bazar) et on aperçoit de l’autre côté l’Astana et le fort Margherita, écrasés aujourd’hui par le tout nouveau bâtiment de l’Assemblée d’Etat. Kuching est le point de départ pour découvrir les maisons-longues des anciens coupeurs de têtes, ici, en pays Bidayu, à 15 km en amont de la rivière Sarawak. En 1973, la reddition des derniers communistes et l’ouverture de la route permettra aux touristes de partir à la découverte du pays Iban (…)
Enfin la troisième étape nous emmène de l’autre côté de la Mer de Chine, en Malaisie orientale, au Sarawak, dans la capitale des Rajahs Blancs : Kuching. Le premier hôtel de la ville à offrir des baignoires avec l’eau chaude, et l’air conditionné est l’Aurora (on a construit depuis l’hôtel Merdeka à la place). On se promène au long de la rivière (Main Bazar) et on aperçoit de l’autre côté l’Astana et le fort Margherita, écrasés aujourd’hui par le tout nouveau bâtiment de l’Assemblée d’Etat. Kuching est le point de départ pour découvrir les maisons-longues des anciens coupeurs de têtes, ici, en pays Bidayu, à 15 km en amont de la rivière Sarawak. En 1973, la reddition des derniers communistes et l’ouverture de la route permettra aux touristes de partir à la découverte du pays Iban (…)
Vingt cinq ans plus tard, le tourisme est devenu un secteur d’activité prioritaire. La Malaisie a son ministre du tourisme et a ouvert un bureau à Paris. Une des principales destinations touristiques développées pendant ces années-là, chasse gardée du premier ministre de l’époque, le Dr Mahathir, s’appelle Langkawi, un archipel d’îles situées sur la côte ouest, sous la frontière thaïlandaise. L’action de L’amour fou du colonel Chang s’y passe pour l’essentiel. On vous y indique les hôtels, où descendre selon votre budget : l’Awana et le Burau Bay, mieux le Pelangi ou le luxueux Datai. On vous présente les attractions touristiques, côté mer, l’île de la femme enceinte et son lac d’eau douce, côté terre, la ferme aux crocodiles (…)
Nous sommes bien en présence d’un produit touristique. On peut même penser que le voyage de repérage, tant les détails précis abondent, a été sponsorisé par l’Office National du Tourisme de la Malaisie. A un détail près toutefois, l’auteur ne fait pas de cadeau à la Malaisie, il la « massacre » même. Les femmes malaises sont « bâchées », Kuala Lumpur n’est qu’un magma de gratte-ciel hideux, les tours jumelles Petronas, les plus hautes du monde, sont aussi les plus laides. La voiture nationale, la Proton est un veau… Ce qu’ils appellent la cuisine nunya (nyonya), moitié chinoise, moitié malaise : c’est infect. On ne peut pas se fier aux Malais : leur éthique, c’est le ringgit. Bref, on n’est guère habitué à ce genre de commentaires dans les publications touristiques.
Du cliché à la caricature
Le nom de Malaisie a du mal à s’imposer. Sur les cinq derniers romans, un seul inclut le nom de Malaysia. Sa jeunesse n’y aide pas. Il lui faut du temps pour se dégager de l’ombre de Singapour, la comparaison reste omniprésente. La division géographique est un handicap. Malaisie et Bornéo ne sont pas des notions équivalentes. L’une est un pays, l’autre est une île, divisée en trois entités politiques (Brunei, Indonésie et Malaisie). C’est une ancienne colonie anglaise, et la mosaïque humaine n’en favorise pas la compréhension, pas plus que l‘approximation factuelle dont ces romans font leur aubaine.
 Le plus souvent, la description est basée sur un cliché. Ce cliché ne peut que venir renforcer une image déformante. Ainsi dans Sabotages en Malaisie, les Jaunes tiennent le commerce, la finance, l’industrie… Et si par hasard il vous arrive de rencontrer un homme assis sur une chaise ou un banc, lisant, rêvant, flânant ou devisant avec un compatriote, vous serez alors en présence d’un Malais. Voilà parfaitement résumé le mythe du Malais paresseux et du Chinois besogneux. Plus grave encore, bien souvent le cliché tombe dans le biais raciste, qu’il soit ethnique ou religieux. Et le cliché devient caricature.
Le plus souvent, la description est basée sur un cliché. Ce cliché ne peut que venir renforcer une image déformante. Ainsi dans Sabotages en Malaisie, les Jaunes tiennent le commerce, la finance, l’industrie… Et si par hasard il vous arrive de rencontrer un homme assis sur une chaise ou un banc, lisant, rêvant, flânant ou devisant avec un compatriote, vous serez alors en présence d’un Malais. Voilà parfaitement résumé le mythe du Malais paresseux et du Chinois besogneux. Plus grave encore, bien souvent le cliché tombe dans le biais raciste, qu’il soit ethnique ou religieux. Et le cliché devient caricature.
Le roman d’espionnage est un véritable guide touristique, il en a les inconvénients. Il devient obsolète rapidement. La description erronée crée une attente trompeuse, source de déception chez le voyageur mal informé et pressé. Mais peut-on encore considérer une description au vitriol comme une invitation au voyage ? Assurément, une règle d’or de la communication aujourd’hui n’est-elle pas : mieux vaut être caricaturé qu’oublié !
Une chose est sûre, le genre s’épuise. Il aura été un temps le prolongement du roman d’aventure sur fond d’exotisme qui triompha à l’époque du crépuscule colonial. Ainsi, Un bon coup de malais est aussi un clin d’œil à La Dame de Malacca, 30 ans après, même si l’Udaigor est devenu le Selangor et Rahajang, Kuala Lumpur…
